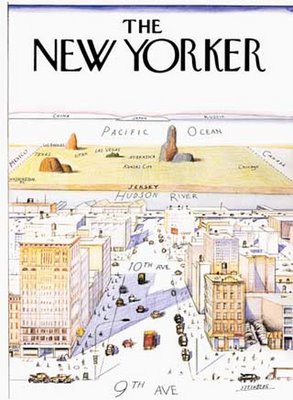Sereine jeunesse, 6
C'est bientôt la fin de la video perdue. Il ne reste plus que quelques images. Il y avait eu la finale de la coupe du monde, l'incroyable Angleterre-Allemagne, les russes s'étaient entassés dans une chambre devant un poste de télé, en noir et blanc bien entendu, avec des bouteilles de Stoloitchnaïa. La grande équipe soviétique de Lev Yachine, considéré alors comme le plus grand gardien du monde, qu'on surnommait "l'araignée noire" ou la "pieuvre noire", venait d'être battue en demi finale par l'Allemagne et cela avait été presque un deuil national. Les russes avaient pris fait et cause pour les anglais, comme pendant la guerre, et ils les soutenaient encore plus fort que si cela avait été leur propre équipe. On ne soupçonne d'ailleurs plus l'ampleur de la haine que les russes éprouvaient à l'égard des allemands (elle était à peu près du même ordre que celle de mes parents qui, dans les années soixante, refusaient d'acheter tout appareil qui portait une marque allemande - ce qui n'était pas si simple car il était reconnu universellement que ces appareils étaient les meilleurs et de loin - et d'ailleurs je souçonne qu'une des causes de la russophilie de bien des gens de leur âge, pas seulement les communistes, tenait à leur haine commune des allemands) On était encore moins de vingt ans après la fin de la guerre. Il y avait eu dans ce pays des millions de morts, infiniment plus qu'en France même en ajoutant les morts des deux guerres, on a tendance à l'oublier. Nous nous étions donc joints aux russes devant la télé qui, quelques jours avant, comme on le voit sur la vidéo qui est, je le redis, une copie du film super huit original, nous avaient collé la patée lors d'une olympiade de jeux de plage - ils adoraient ça, les olympiades, les russes à cette époque, ils donnaient le nom d'olympiades à toutes leurs joutes, y compris les courses en sac, comme on pourrait le voir sur le film et la video perdue, ce sont des images qui ont existé mais qui n'éxistent plus que dans ma mémoire - et nous avions joint nos applaudissements aux leurs quand Hurst, ce héros, avait marqué le troisième but dont on ne sait toujours pas de nos jours s'il était vraiment entré (on le passe et repasse à des ordinateurs qui n'arrivent toujours pas à prendre position pour ou contre). Nous étions vraiment contents pour eux et pas tellement pour les anglais contre qui nous avions piteusement perdu trois semaines auparavant. On avait fêté ça toute la nuit à grand renforts de toasts à la Stolitchanaïa en l'honneur des amitiés sovieto-britanniques, franco britanniques, franco-soviétiques et de bains de minuits tout habillés, barbouzes, officiels, camarades, guides et touristes studieux tous mélangés dans la grande fraternité du ballon rond. Deux ou trois jours après tout le monde avait réussi à retrouver son sérieux pour la visite des cosmonautes. il y en avait eu deux d'un coup, qu'on avait sortis spécialement de la cité des étoiles pour nous. Ils ne sentaient pas la naphtaline mais presque. Je me souviens que l'un des deux était le colonel Komarov qui se crashera quelques années plus tard dans l'un des seuls accidents de capsule spatiale reconnu par l'URSS et deviendra un héros de l'Union Soviétique posthume, je peux me glorifier d'avoir fréquenté un héros de l'Union Soviétique, oui. Ils n'étaient pas venus avec leurs combinaisons de bonhomme Michelin mais avec leurs uniformes de colonels de l'Armée Rouge, leur casquettes étoilées et leur panoplie complète de médailles pectorales souveraine contre l'asthme et autres maladies bronchiques. Les quinze secondes d'images sombres, qui seraient, je le répète, donc devenues un document rare et exceptionnel si elles n'avait pas été perdues dans ce déménagement, où on les distingue, tels des demi-dieux, signant des autographes avec la certitude du devoir accompli et la supériorité tranquille que conférait le titre de représentant de la Patrie du Socialisme, sont pourtant dues à l'éclairage d'appoint fourni par la télevision soviétique convoquée pour la circonstance. J'ai d'ailleurs eu droit à un coup d'oeil, en tant que collègue avec ma petite super huit, dans le viseur (d'une taille incroyable) d'une caméra de télévision qui n'était pas encore à l'époque portable, même à l'épaule, mais montée sur un lourd trépied en bois qu'il avait fallu installer à l'avance. La visite, qui avait été préparée pendant au moins une journée et demie, avait duré en tout et pour tout disons sept minutes et puis les gentils cosmonautes étaient remontés dans leurs jolies petites capsules spatiales en faisant des signes de la main et il s'étaient envolés, comme ça, vers la cité des étoiles... L'avenir radieux venait de nous effleurer les cheveux. Plus rien de grave ne pouvait plus nous arriver. Il ne nous restait plus qu' à acheter les cadeaux souvenir. On nous amena donc la veille du départ dans un magasin de souvenirs d'état ou dans un magasin d'état de souvenirs. Cela existait, à l'époque. Il n'y avait d'ailleurs que là où on nous laissait acheter quoi que ce soit et il fallait bien veiller à rendre tous nos roubles avant de partir. On ne pouvait garder que les kopecks et les pin's. Malgré les prix d'état les chapkas et les samovars dont mes parents auraient rêvé étaient très au-dessus de mes moyens. Ils eurent donc droit à une cuillère en bois peinte en rouge et or dont les stocks étaient tels qu'on les écoule pour trois fois rien encore quarante ans plus tard dans les marchés de Noël avec le même succès indémenti, une petite poupée de moujik toquée et bottée qui trône encore, quarante ans après elle aussi sur le poste de télévision familiale et une bouteille de vodka Stolitchnaïa, bien entendu. Le retour se fit en Iliouchine par l'Aéroflot et les images de l'aéroport de Moscou sont les dernières qu'on peut voir sur le film super huit perdu, mais de celles-là je ne me souviens plus du tout. Il n'y eu plus de pellicule pour la fin du voyage. Mais le souvenir est bien plus fort que la pellicule. Je serai donc en mesure de le raconter dans le prochain et dernier épisode de "Sereine Jeunesse". Il s'intitulera : "Dresde ou les aventures de Ciscoblog en RDA". Bientôt sur cet écran.